La
méthanisation
en station d'épuration
Les
eaux usées sont les eaux résiduaires provenant de
la population mais aussi des activités industrielles
et commerciales.
Le traitement de ces eaux usées est souvent réalisé
de manière collective dans une station d'épuration.
|
|
|
La
France métropolitaine compte 19 521 stations d'épuration en
activité (données du portail de l'assainissement, Ministère
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2014)
dont 88 possèdent actuellement une unité de méthanisation sur
site pour le traitement des boues.
 Comment
fonctionne une station d'épuration à boues activées
? Comment
fonctionne une station d'épuration à boues activées
?
Le système
d’épuration couramment utilisé par les stations d’épuration
est celui de la « boue activée en aération prolongée ».
Ce système est très répandu et utilise l’épuration biologique.
Ces stations sont installées à l’extrémité du réseau de collecte,
juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel.
Elles rassemblent une succession de dispositifs, empruntés
tour à tour par les eaux usées. Chaque dispositif est conçu
pour extraire au fur et à mesure les différents polluants
contenus dans les eaux.
La succession de ces dispositifs est, bien entendu, calculée
en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le
réseau et des types de pollutions à traiter.
-
Une phase de pré-traitement
Elle consiste en l’élimination
des gros débris solides, sables, corps gras, à l’aide
de procédés de dégrillage, dessablage et de dégraissage.
On enlève ainsi de l’eau les éléments grossiers et les
sables de dimension supérieure à 200 microns ainsi que
80 à 90 % des graisses et matières flottantes (soit 30
à 40 % des graisses totales).
-
Une phase de traitement
biologiques
Ces traitements sont indispensables
pour extraire des eaux usées les polluants dissous, essentiellement
les matières organiques (pollution carbonée, parfois azotée
et/ou phosphatée). Les bactéries se développent dans des
bassins alimentés d’une part en eaux usées à traiter et
d’autre part en oxygène par des apports d’air. Les bactéries,
en suspension dans l’eau des bassins, sont donc en contact
permanent avec les matières polluantes dont elles se nourrissent
avec l’oxygène nécessaire à leur assimilation.
-
Dans tous les cas
La séparation de l’eau
traitée et de la masse des bactéries (que l’on appelle
« boues ») se fait dans un ouvrage spécifique appelé "clarificateur".
La conséquence de l’assainissement des eaux usées est
: la production de boues d’épuration,
constituées de bactéries mortes et de matières organiques
minéralisées.
-
La valorisation des boues
La méthanisation est le processus
de transformation de la matière organique en biogaz. Ce
biogaz est essentiellement composé de méthane (CH4)
et de gaz carbonique (CO2).
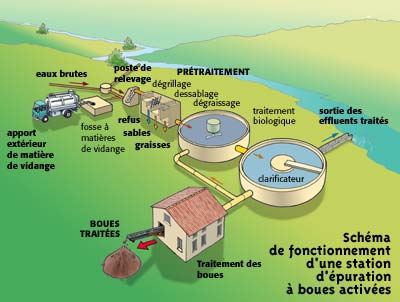
Schéma
de fonctionnement d'une station d'épuration à boues activées
Le
schéma ci-dessous présente de manière
synthétique le fonctionnement d'une installation de
traitement des eaux résiduaires urbaines conventionnelle
dotée d'un processus de méthanisation des boues.
Il présente aussi quatre voies de valorisation possibles
du biogaz produit ainsi que trois optimisations majeures envisageables.
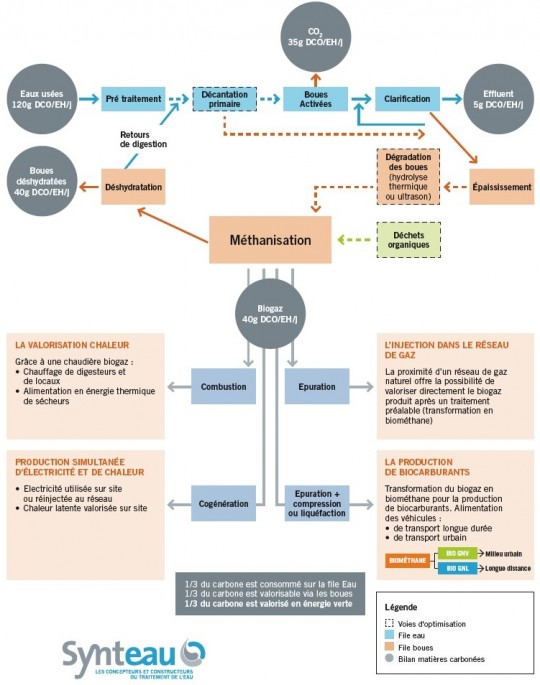
 La méthanisation des boues d'épuration,
quels bénéfices pour les exploitants de stations d'épuration
des eaux ?
La méthanisation des boues d'épuration,
quels bénéfices pour les exploitants de stations d'épuration
des eaux ?
- Environnementaux
et sanitaires
Production d'énergie renouvelable - contribution à l'autosuffisance
énergétique
des installations de traitement des eaux usées;
- Amélioration de l'empreinte environnementale
des installations;
- Réduction du volume des boues issues du traitement des
eaux usées et
donc réduction des nuisances environnementales
liées au transport et au
devenir de ces boues;
- Stabilisation et hygiénisation
des boues;
- Économiques
Réduction des coûts d'exploitation découlant de la
filière
de traitement des boues;
- Revente d'énergie renouvelable à un tarif préférentiel;
- Réduction des besoins thermiques
des installations;
- Création d'emplois
locaux non délocalisables en construction, maintenance,
exploitation.
 L'optimisation de la production du biogaz
L'optimisation de la production du biogaz
Il
existe des méthodes, qu'il est possible d'utiliser simultanément, permettant de maximiser la production de biogaz :
-
L'intégration
d'une décantation primaire
Les
boues issues de la décantation primaire, dites « boues primaires » sont plus fortement
chargées en matière
organique que les boues issues de la clarification, dites « boues biologiques
».
Ainsi la production de biogaz
par
digestion des boues
mixtes (boues primaires + boues
biologiques) est optimisée par rapport à celle obtenue uniquement par digestion des
boues biologiques.
-
La
dégradation des boues d'épuration avant
digestion
Il
est possible d'optimiser la production de biogaz en dégradant les boues d'épuration avant digestion
par hydrolyse (notamment
thermique et par ultrason.
Les boues d'épuration
ainsi dégradées libèrent une quantité
plus importante de matière organique et permettent ainsi une
production de biogaz plus importante.
-
La
co-digestion
La technique de co-digestion consiste à
méthaniser dans le même réacteur les boues
issues du traitement des eaux usées et des biodéchets fermentescibles. La production
de biogaz est ainsi
dopée par ces apports externes. De plus,
ces apports permettent de maintenir une production
stable et constante. Il est
important que ces filières
soient bien préparées à
l'amont avec les différents acteurs locaux (syndicats,
collectivités).
 La purification
du biogaz avec PTC System
La purification
du biogaz avec PTC System
P.T.C.
System s'inscrit aujourd'hui principalement dans le domaine
de la méthanisation des déchets (purification
des biogaz), un domaine particulièrement en pointe.
Selon
l’Ademe, la filière pourrait assurer plus de 14 % de la consommation
française de gaz en 2030.
Dans son document “Contribution à l’élaboration de visions
énergétiques 2030-2050”, l’agence évalue qu’avec 600 installations
de méthaniseurs par an (soit presque deux fois moins qu’en
Allemagne), le gisement accessible serait de 6 Mtep primaires
en 2030 (soit 20 % de la consommation de gaz estimée pour
cette période).
Quelle
que soit la nature du biogaz, le système PTC sépare
le biogaz de ses impuretés (CO2, H2S, COV, Siloxanes).
Le taux de méthane du biogaz passe alors de 45 % à 98 % et
peut être directement injecté dans le réseau national de distribution
de gaz de ville.
L’avantage de notre procédé PTC est qu’il utilise une technologie
fiable, robuste, largement éprouvée et provenant directement
de l’industrie.
Ce système s'adapte en fonction de la variation de la richesse
en méthane selon la composition du biogaz brut entrant.
 Voir
PTC System
Voir
PTC System
 Estimation de l'énergie produite
à partir du biogaz
Estimation de l'énergie produite
à partir du biogaz
Les
chiffres suivants sont calculés pour du biogaz à
65% de méthane
-
Cogénération
Lors de la cogénération du biogaz, 1 kg de
matière volatile (MV) éliminée
produit environ 1 Nm3 de biogaz.
Cela signifie qu'environ 7 Nm3/an de
biogaz sont produits par équivalent habitant.
Après cogénération du biogaz on obtient une production d'environ 12,6 kWh/an/EH de chaleur et 15,4 kWh/an/EH d'électricité.
-
Injection
du biométhane dans le réseau de gaz naturel
La
production annuelle de
biométhane injecté dans le réseau est estimée
à environ 3,5 Nm3/an pour 1 EH
(on estime que le biométhane
produit correspond à
50 % du volume
de biogaz produit et
75% du PCS du biogaz
produit).
La production de biométhane
est ainsi équivalente à environ 35 kWh/an/EH PCS.
 Les 6 points forts de la méthanisation
des boues de STEP
Les 6 points forts de la méthanisation
des boues de STEP
-
Elle contribue à diminuer l’effet de serre pour tous les sous-produits à condition
d’éliminer le CO2, en évitant la décomposition
à l’air libre de la matière organique et en se substituant aux
énergies fossiles.
-
Elle
fournie un bio-engrais naturel hygiénisé qui peut être utilisé par les agriculteurs
locaux.
-
Elle assure des
fonctions d’épuration et d’assainissement en
transformant des effluents en engrais et amendements.
-
Elle participe à
la mise en place d’une économie circulaire territoriale en abaissant
le coût de retraitement des déchets.
-
Elle produit localement
une énergie
exploitable à bas coût :
eau chaude, vapeur, biogaz et produit de l’électricité
revendue à EDF
-
C’est une solution
pour la mise
en conformité du recyclage des déchets permettant d’assurer traçabilité et valorisation.
|
![]() Valorisation
Valorisation